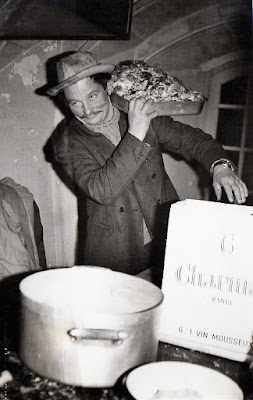|
| Préparation du réconfort |
Creully sur Seulles
Creully sur Seulles et ses environs, des villages aux multiples histoires

Creully (Creully sur Seulles) - Il meurt dans le brasier d'une meule de foin.
En ce mois de septembre 1848, alors que les feuilles commençaient à peine à se parer des teintes dorées de l’automne, un drame d’une violence inouïe vint frapper le paisible bourg de Creully. Un incendie, aussi soudain que dévastateur, s’abattit sur les terres laborieuses, semant la désolation et la terreur dans le cœur de ses habitants. Les langues de feu, avides et impitoyables, léchèrent le ciel avec une fureur infernale, réduisant en cendres les fruits
d’une année de labeur. Trois meules immenses, symboles de la sueur et de l’espoir des paysans, furent englouties par ce brasier monstrueux : deux d’entre elles, composées de foin et de chaume de colza, et une troisième, colossale, renfermant près de six mille gerbes de blé, propriété du sieur Lecoq, cultivateur respecté de la région. En quelques instants, ce qui devait nourrir les familles pendant les longs mois d’hiver ne fut plus qu’un amas de braises fumantes, un rêve consumé par la fournaise.Mais c’est dans
l’adversité que l’âme humaine révèle sa grandeur. Et ce jour-là, les habitants
de Creully répondirent à l’appel du devoir avec une promptitude et un courage
qui forcent l’admiration. Hommes, femmes, enfants, tous accoururent, le visage
marqué par l’angoisse, les mains tremblantes mais déterminées, pour tenter
d’endiguer la marche destructrice des flammes. Leurs cris se mêlaient au
crépitement sinistre du feu, leurs seaux d’eau semblaient dérisoires face à
l’ampleur du désastre, et pourtant, aucun ne recula. Leur dévouement, aussi pur
que désintéressé, illumina cette nuit de cauchemar d’une lueur d’humanité.
Parmi ces âmes
héroïques, un homme se distingua par un acte de bravoure qui devait lui coûter
la vie. Jean-Louis Massier, un
ouvrier menuisier originaire de Bayeux, venu prêter ses bras à
Creully, aperçut la meule de foin, la plus imposante et la plus menaçante de
toutes. Elle se dressait telle une tour de paille, prête à s’effondrer et à
propager l’incendie jusqu’aux premières maisons du bourg. Sans hésiter, sans
songer à sa propre sécurité, il s’élança vers elle, comme poussé par une force
supérieure. À peine avait-il atteint son sommet que, sous ses pieds, la
structure, rongée par les flammes, céda dans un grondement sourd. La meule
s’affaissa, entraînant dans sa chute le malheureux Massier, qui disparut dans
le cœur même de l’enfer. Les témoins, pétrifiés d’horreur, entendirent à peine
son dernier cri étouffé par le rugissement du feu. Malgré les efforts
désespérés de ses compagnons, qui se précipitèrent pour le sauver, rien ne put
arracher son corps aux griffes de la fournaise. Quand enfin on parvint à le
retirer des décombres, il n’en restait qu’une dépouille méconnaissable, un
témoignage muet et poignant de son sacrifice.
Le sort ne se contenta
pas d’une seule victime. Jean Binet, conducteur
d’une des voitures reliant Creully à Caen, fut lui aussi happé
par la voracité des flammes. On le retira, vivant mais à peine, de cet abîme de
feu. Son visage et le haut de son corps portaient les stigmates de sa bravoure
: des brûlures si profondes et si étendues qu’elles semblaient avoir marqué sa
chair à jamais. Les médecins, le visage grave, murmurèrent des paroles
d’espoir, mais tous savaient que la route vers la guérison serait longue et
douloureuse. Pourtant, dans ses yeux fiévreux, une lueur de vie persistait,
comme pour rappeler que le courage, parfois, triomphe de la mort elle-même.
Un autre Creullois,
dont le nom ne nous est pas parvenu, fut également touché par le brasier, mais les cieux, cléments
envers lui, lui épargnèrent le pire. Ses blessures, bien que
douloureuses, n’étaient que légères en comparaison du sort de ses compagnons.
Ainsi, en cette
journée funeste, Creully pleura ses héros
et ses rêves consumés. Les flammes, enfin domptées, ne laissèrent
derrière elles que des cendres et des souvenirs de bravoure. Et tandis que le
soleil se couchait sur le bourg endeuillé, une question résonnait dans l’esprit
de tous : comment oublier ceux qui, sans hésiter, avaient offert leur vie pour
sauver celle des autres ?
Creully (Creully sur Seulles) - Les douches municipales de Creully.
La foire de Saint Gabriel de 1638 (Creully sur Seulles)
Elles avaient lieu une ou plusieursfois par an et rassemblaient les paysans, les artisans et les marchands venus vendre ou acheter toutes sortes de produits : animaux, outils, vêtements, nourriture ou tissus.
Mais les foires n’étaient pas seulement des lieux de commerce. C’était aussi un moment de fête et de rencontre. On y écoutait de la musique, on assistait à des spectacles, et les habitants des villages voisins s’y retrouvaient.
Les foires animaient la vie rurale et permettaient aux habitants de gagner de l’argent et d’échanger des nouvelles. Elles faisaient partie du rythme de vie traditionnel des campagnes avant l’arrivée des grands marchés et du commerce moderne.
Je vous invite à retourner dans le passé; plus précisemment en 1638 dans la petite localité de saint Gabriel connue pour son prieuré.
Un document, conservé aux archives départementales du Calvados, présentel'organisation, les marchands et les artisans présents. J'ai essayé de déchiffrer les noms des métiers.
Voyez la liste ci-dessous.
Crocher (crocheteur)
Boullenger
Parfois nommé « bollengier », il préparait et cuisait des pains dont le
poids et le prix étaient fixés par un magistrat. L’équivalent de nos boulangers
actuels.
Bouchera
Homme que nous appelons aujourd’hui « boucher » : il abattait lui-même le
bétail et vendait ensuite la viande au détail.
Cuisiniera
Désignait souvent une domestique cuisinière attachée à une maison
particulière.
Diappera (drapier)
Chappellier
Fabriquait ou vendait des chapeaux (en feutre, paille, tissu, etc.).
Mesnuissiers
Construisait le mobilier (tables, chaises, etc.).
Cribleur
Fabriquait des cribles, cercles de bois sur lesquels étaient tendues des
peaux percées.
Cordonniera
Fabriquait, vendait et réparait des chaussures.
Lanterniera
Fabriquait des lanternes.
Escrinier (écrinier)
Merciera
Vendait du matériel concernant la couture et du tissu.
Barillier
Fabriquait des barils et des tonneaux.
Savettiers
Fabriquait et réparait des souliers.
Vendeur de toile
Vendait de la toile.
Lanterniers
Fabriquait des lanternes ou était chargé d’allumer les lanternes publiques.
Bourlier (Bourrelier)
Chauderonnier
Fabriquait et vendait des ustensiles de chaudronnerie.
Quincailler
Vendait des ustensiles en métal.
Blanchisseur
Désignait parfois l’artisan spécialiste du blanchiment des maisons à la
chaux.
Peussier (peaussier)
Vendeurs de bas et lingette
Vendait des effets pour l’habillement des dames (bas, linge).
Tavernier
Tenancier de taverne, où l’on vendait le vin « au pot ».
Traileurs (Bracier)
Le curé d’Arromanches et la chaire d’Asnelles
Dans le modeste bourg d’Arromanches, niché au creux des
vagues et des brises marines, résidait un curé dont la renommée de prédicateur
transcendait les frontières de la petite localité.
Ce dimanche 7 juillet 1833, l'église Saint-Martin
d’Asnelles, avec sa nef baignée de lumière et son chœur empreint de solennité,
s'apprêtait à accueillir un événement des plus remarquables. Le curé, drapé
dans l'aura de sa sagesse, avait été convié à y prononcer un sermon depuis la
chaire de bois, vieille sentinelle sculptée, témoin silencieux des siècles
passés, située à gauche de la nef, non loin du chœur.
Eglise d'Asnelles
Les cloches de l'église, dans leur élan frénétique,
semblaient vouloir fendre l'air de leurs vibrations, appelant les fidèles et
les moins croyants à se rassembler. Ce jour-là, même les agnostiques, poussés
par une curiosité insatiable, avaient trouvé place parmi l'assemblée, avides
d'entendre ce sermon annoncé comme inspiré par le Saint-Esprit lui- même.
L'église, dans son ensemble de pierres et de bois, n'avait jamais connu
pareille affluence.
L'abbé Rémy, enveloppé dans sa chasuble brodée de fils
d'or et d’argent, s'éleva lentement vers la chaire, cette pièce de bois
sculpté, vestige d'une époque où même les vers hésitaient à s'attaquer au chêne
béni. Depuis vingt minutes, il captivait un auditoire nombreux et attentif,
posant les fondations solides de l'église catholique avec une éloquence qui,
bien que parfois interminable, faisait de lui un homme aussi dévoué que redouté
pour ses longs discours.
La corpulence du prédicateur, jointe à la chaleur de
son débit et à la gestuelle qui accompagnait ses paroles, ajoutait une
dimension presque théâtrale à son sermon.
— Qu'ils
prennent corps, bien, honneur, femme et enfants ; laissons-les faire, ils n'y
gagneront rien. Le Royaume doit nous rester ! S’exclama-t-il, s'adressant à ses
ouailles attentives.
— Il nous
restera, ajouta-t-il avec une ferveur grandissante, le Royaume de Dieu sur la
terre, dans l'abaissement, dans le dénuement, dans l'opposition peut- être ;
mais certainement un jour dans le ciel, dans la gloire infiniment excellente de
l'éternelle béatitude de Jésus-Christ.
— Voici
l’Esprit, mes bien-aimés, dont l’assistance nous est nécessaire si nous voulons
travailler dignement à l’édification de l’Église de Dieu...
— Les bases de notre église sont indestructibles.
—Mais au
moment précis où il leva les bras au ciel pour condamner l’orgueil des hommes
qui s’élèvent trop haut, un craquement sourd, semblable à un grondement
céleste, retentit dans l'église.
Les paroissiens, saisis d'effroi, échangèrent des
regards interrogateurs, cherchant en vain l'origine de ce bruit sinistre. La
réponse ne se fit pas attendre : un nuage de poussière s'éleva soudain sous la
chaire, et leur curé bien-aimé disparut de leur vue.
Ce ne fut pas le cri du religieux qui se fît entendre,
mais celui d'une paroissienne, sérieusement blessée par l'incident. L'homme de
Dieu, se reprenant avec une dignité admirable, déclara d'une voix ferme :
— Mes
frères, le Seigneur a parlé. Il préfère l’humilité à la hauteur. Désormais, je
prêcherai du sol.
Rameau de pommier de Noël, rameau d’espérance
La nuit de Noël étendait son manteau d’étoiles sur les campagnes normandes endormies, et le gel argentait les branches des pommiers comme une bénédiction discrète. Dans les hameaux perdus, où les traditions se chuchotent de génération en génération, les jeunes filles aux joues rosies par le froid et l’espoir revenaient de la messe de minuit, le cœur battant à l’unisson des cloches lointaines. Leurs doigts gourds effleuraient les rameaux des arbres, et chacune d’elles en choisissait un, qu’elle glissait dans une fiole d’eau pure, suspendue ensuite à sa fenêtre comme une offrande au destin. « Si un seul bourgeon s’ouvre avant Pâques, disait la légende, l’année verra naître un amour. » On nommait cela une Pâque fleurie, ce fragile présage où la nature elle-même semblait conspirer en faveur des rêves les plus secrets.
Parmi
les ombres mouvantes d’un château, forteresse médiévale, près de Caen, vivait
Pauline, une jeune Bretonne au visage pâle et aux yeux clairs comme les
ruisseaux de son pays. Son pas était léger, sa voix douce, et son âme aussi
pieuse que celle d’une sainte. Mais le sort, en sa cruauté, lui avait imposé
une bosse, ce fardeau invisible qui alourdissait chaque regard posé sur elle.
Les autres servantes la toisaient, mi-amusées, mi-méprisantes, et Pauline,
résignée, portait sa différence comme une pénitence. Pourtant, en son for
intérieur, elle gardait intacte la flamme d’un espoir têtu.
Cette
nuit-là, tandis que ses compagnes, insouciantes, regagnaient leurs chambres en
riant, elle s’attarda sous les pommiers noirs, leurs silhouettes découpées dans
la lune comme des sentinelles veillant sur les rêves. D’un geste furtif, elle
détacha un rameau, le serra contre sa poitrine et murmura une prière. «
Seigneur, si Vous existez, faites que cette branche fleurisse… »
Puis, le cœur battant, elle la déposa dans une fiole qu’elle déposa près de la
fenêtre de sa chambre, comme un secret confié à la nuit.
Mais
les murs ont des oreilles, et les cœurs légers aiment à se repaître des
faiblesses d’autrui. Une langue venimeuse divulgua son geste, et bientôt,
l’office entier se gaussa de la « folle bossue » et de sa crédulité. «
Une Pâque fleurie ? Pour elle ? » Les rires claquaient comme des
fouets, et Pauline, les joues brûlantes, feignait de ne pas entendre. Elle
priait, encore et toujours, les mains jointes, les yeux levés vers le rameau
qui refusait de s’éveiller.
Le
samedi saint, alors que l’espoir de Pauline s’étiolait comme la branche dans
son eau, un des jardiniers, complice d’une farce cruelle, substitua au rameau
fané une tige constellée de fleurs roses, aussi artificielles que les sourires
qui allaient bientôt se moquer d’elle. Quand, au matin, elle découvrit le «
miracle », son visage s’illumina d’une joie si pure, si radieuse, qu’on aurait
cru voir un ange descendre sur terre. « C’est un signe ! »
s’exclama-t-elle, les yeux brillants, serrant contre elle le bouquet comme une
preuve de la clémence divine.
Mais
les moqueurs guettaient. À peine eut-elle franchi le seuil de l’office que les
éclats de rire explosèrent, les quolibets pleuvaient, et les regards se firent
plus durs que la pierre. « Regardez-la, la bossue ! Elle croit
encore aux contes ! » Les larmes montèrent aux yeux d’Pauline,
grosses, silencieuses, roulant sur ses joues comme des perles trahies. C’est
alors que la porte s’ouvrit, et la châtelaine apparut, son visage noble
empreint d’une colère froide. « Assez, » dit-elle d’une
voix qui fit taire les rires. La lingère, honteuse, lui avait tout raconté : la
cruauté du jeu, la naïveté de Pauline, et cette foi inébranlable qui, malgré
tout, persistait.
S’avançant
vers la jeune fille, la dame du château prit délicatement le rameau fleuri et y
enroula un billet de mille francs, avant de le lui tendre avec une gravité
solennelle. « Pauline, » dit-elle, «
cette Pâque fleurie ne vous aura pas menti. Vous êtes une âme honnête, et le
bonheur vous est dû. Puisse cette dot vous ouvrir les portes d’un avenir où
l’on saura vous aimer comme vous le méritez. »
Les
jours qui suivirent virent le jardinier, honni pour sa participation à la
mystification, tenter de racheter sa faute en demandant la main de Pauline.
Mais celle-ci, avec une dignité qui surprit jusqu’à ses bourreaux, refusa
poliment. « Mon cœur, » murmura-t-elle,
« a déjà choisi un autre chemin. »
Et
c’est ainsi que Pauline, la bossue au sourire timide, devint la preuve vivante
que les miracles existent — non pas dans l’éclat des fleurs trompeuses, mais
dans la résilience de ceux qui, malgré les railleries du monde, osent encore
croire en la douceur de la vie. Car parfois, il suffit d’un rameau, d’une
larme, et d’un peu de lumière pour que l’impossible devienne réalité.
Nos bêtes nous informent...
Dans un petit village perdu au cœur
du Calvados, là où les collines douces se marient aux vieux pommiers et où le
vent murmure des secrets à travers les haies bocagères, un étrange livret vient
d’être distribué aux habitants. Son titre, Lectures choisies pour les
campagnes, de Louis Halphen, résonne comme une invitation à redécouvrir les
mystères de la nature, ces signes subtils que le ciel et la terre offrent à
ceux qui savent encore écouter. Parmi les pages jaunies par le temps et l’odeur
de foin, un chapitre attire particulièrement l’attention : celui qui enseigne
l’art délicat de décrypter les présages de la pluie. Car, voyez-vous, la pluie
n’arrive jamais sans avertir. Elle s’annonce, telle une voyageuse discrète, par
une symphonie de gestes et de murmures que seuls les cœurs patients et observateurs
peuvent percevoir.
L’auteur, avec la minutie d’un
peintre décrivant les nuances d’un coucher de soleil, dresse une liste de ces
signes, si curieuse, si savoureuse, qu’il serait dommage de la laisser sombrer
dans l’oubli. Alors, laissez-moi vous conter, comme on raconte une légende au
coin du feu, ces augures qui font frissonner les campagnes avant que les
premières gouttes ne viennent caresser la terre assoiffée.
humaient l’humidité lointaine. Puis, d’un mouvement lent et solennel, elles se blottissent dans un coin reculé du pré, ou cherchent refuge sous les hangars de bois vermoulu, comme si une intuition ancienne les poussait à se préparer. Leurs flancs massifs frôlent l’herbe avec une lenteur inhabituelle, et leurs yeux, habituellement si calmes, semblent interrogateurs.
Les gardiens des pâturages Les moutons, d’ordinaire si insouciants, résistent soudain à s’éloigner des pâturages. Leurs pas traînent, leurs bêlements deviennent plus sourds, comme s’ils pressentaient que l’herbe, bientôt, sera lourde de rosée et de pluie. Ils restent groupés, têtes basses, comme un troupeau de sages attendant l’orage.
collines, abandonnent leurs jeux et se pressent vers les abris, leurs sabots légers frappant le sol avec une hâte inhabituelle. Quant aux ânes, ces philosophes à longues oreilles, ils se mettent à braire avec une insistance étrange, secouant leurs oreilles comme pour chasser un pressentiment importun.
Les fidèles compagnons du foyer Autour des maisons, les chiens, d’ordinaire si vifs, se lovent contre la pierre chaude de l’âtre. Leurs yeux mi-clos, leur respiration lente trahissent une somnolence inhabituelle, comme s’ils rêvaient déjà du crépitement des gouttes sur les tuiles. Ils ne quittent plus le foyer, comme si le feu était le dernier rempart contre l’humidité qui s’annonce.
Les volatiles et leurs concerts Le coq, ce réveille-matin infatigable, se met à chanter à des heures indues. Ses cris perçants déchirent le silence, et ses ailes battent l’air avec une frénésie qui n’appartient qu’aux soirs de tempête. Les canards et les oies, d’ordinaire si paisibles, élèvent la voix en un concert désordonné, comme s’ils se passaient un message secret. Le coq d’Inde, lui, pousse des gloussements aigus, interminables, comme un héraut annonçant l’arrivée d’un roi invisible.
insistance lugubre, comme si elle pleurait déjà la lumière qui va s’éteindre. Les poules d’eau, habituellement si discrètes, se plongent dans les mares avec une frénésie inattendue, se débarbouillant avec une énergie qui semble presque joyeuse.
Les travailleurs de l’ombre Sous terre, la taupe redouble d’ardeur, creusant ses galeries avec une fièvre nouvelle, comme si elle voulait achever son œuvre avant que la terre ne devienne boue. Les crapauds, par dizaines, sortent de leur retraite, leurs corps ventrus glissant sur le sol humide. Les grenouilles, assises sur leurs feuilles, coassent en chœur, leur chant monotone résonnant comme un compte à rebours.
Les danseurs du vent Les cygnes domestiques, majestueux et blancs, s’élèvent dans les airs et volent contre le vent, leurs ailes déployées comme des voiles défiant la tempête. Leurs battements puissants semblent vouloir dompter les éléments avant qu’ils ne se déchaînent.
Les insectes et leurs folies Les mouches, d’ordinaire si paresseuses, deviennent soudain agressives. Elles piquent, tournent en essaims tumultueux, comme si l’électricité de l’air les rendait folles. Les vers sortent de terre, leurs corps roses et luisants traçant des sillons sur le sol.
Ainsi, la nature toute entière semble
retenir son souffle, chaque créature jouant son rôle dans cette symphonie
silencieuse qui précède l’averse. Et quand enfin les premières gouttes tombent,
légères, sur les feuilles et les toits, on comprend que tout cela n’était qu’un
long prélude, une danse secrète entre la terre et le ciel.
Le marché de Bayeux en 1956 un extrait d'un film retrouvé... (suite)
Le marché de Bayeux en 1956 un extrait d'un film retrouvé...
Pierre Salez, habitant des bords de la Seulles à Creully, nourrissait une passion dévorante pour le septième art. L’année 1956 marqua un tournant dans sa vie, lorsqu’il osa saisir sa caméra pour immortaliser, dans un film intimiste, les méandres de cette rivière qui serpentait au cœur de son village natal.
Les décennies s’écoulèrent, emportant avec elles les traces de cette œuvre oubliée. Mais le destin, complice des rêveurs, me permit, après des années d’une quête acharnée, de retrouver ce trésor enfoui dans les limbes du temps.
Aujourd’hui, c’est avec une émotion profonde que je vous convie à en découvrir un extrait. Laissez-vous transporter, le temps de quelques images, vers le marché animé de Bayeux, tel qu’il s’offrait aux regards émerveillés de nos ancêtres… en 1956.
Les séminaristes au petit-séminaire de Villiers le Sec (Creully sur Seulles).
Depuis 1820, un séminaire fut présent sur les terres de Villiers le Sec, non loin de Creully.
Chaque année a lieu la distribution des prix qui commence toujours par l'allocution du Supérieur : "Il est des vérités que l’on ne saurait trop répéter, parce qu’elles sont le principe du bien que nous pouvons opérer dans le fieu de notre exil, et du bonheur qui nous attend, après notre passage dans notre patrie. Ne soyez donc pas surpris si, au moment de terminer vos travaux de l’année, je viens encore vous parler du bon emploi du temps. Vous allez, il est vrai, recevoir les couronnes, prix de vos efforts, et jouir d’un repos nécessaire; mais de nouvelles luttes se préparent et réclament une nouvelle ardeur. Vous voudrez donc bien prêter encore un moment d’attention aux dernières leçons dé l’amitié...."

 |
| La chapelle |
Voici le document qui indique les conditions d'entrée au petit séminaire de Villiers le Sec.
 |
| La boucle du ceinturon des séminaristes |
Creully sur Seulles - La pompe à eau retrouvée...
En me garant rue de Bayeux, à Creully, je suis passé devant l’ancienne gendarmerie. À ma grande surprise, j’y ai aperçu une vieille pompe, vestige d’une époque où les habitants n’avaient pas encore accès à l’eau courante ou n’étaient pas encore raccordés au réseau. J’ai alors pris la liberté de l’immortaliser en photo et d’enquêter sur son histoire en fouillant dans ma collection de documents anciens consacrés à ma commune natale.
 |
| Une ancienne photo nous permet de constater un puit appelé "puit à la colonne". (Collection personnelle de Michel F.) |
 |
| Sur proposition du Maire, il fut décidé en 1865 de remplacer ce puit par une pompe. |
L'arrivée de la fée électrique
Le 13 mars 1880, le Conseil municipal, fut appelé à délibérer sur la question d’installation de réverbères dans le bourg de Creully, décidée par le conseil dans sa séance du onze février dernier.
Monsieur
le préfet ayant demandé, par sa lettre du 18 du même mois de février,
communiquée au Conseil par Monsieur le Maire, à ce que les ressources
applicables à la dépense d’installation soient votées.
Le
Conseil, examinant sur des emplacements où les réverbères devraient être placés
pour éclairer suffisamment toute la partie du bourg, est d’avis que dix
réverbères seraient suffisants.
Et
attendu que d’après les renseignements fournis au Conseil par une maisonspéciale d’éclairage, la dépense d’installation s’élèverait au chiffre de mille
francs d’après un devis rédigé par Monsieur le Maire, d’après les données de la
maison d’éclairage Léon Luchaire, rue Erard, N° 27 et 28, à Paris.
Le
Conseil vote pour faire face à ces dépenses une somme de mille francs à
prélever aux réserves de celle portée éventuellement à cet effet au budget
extraordinaire de l’année mil huit cent soixante-dix-neuf, article 15, votée sans
emploi jusqu’à ce jour.
 |
| Avec l'arrivée de la fée électrique, elle sera surmontée d'un lampadaire. |
 |
| Elle est toujours en place après 1920 mais le point d'éclairage a disparu. |
Villiers le Sec (Creully sur Seulles) - Une nouvelle école choisie par Amours
Il est nécessaire de choisir un homme de bonnes mœurs, capable de s'acquitter de la fonction de maître d’école avec fruit et édification. Il sera nommé et établi par un acte en forme par le donateur sa vie durant et après par le propriétaire du fief de Villiers.
 |
| Emplacement de l'école |
 |
| L'école, rue de Bayeux |
Le dit seigneur donne une salle pour tenir l’école, fermant à porte et serrure, avec des fenêtres garnies de châssis remplis de verre et de treillis de fil de fer en dehors de ladite salle, garnie en dedans d’une table de 13 pieds de long sur 3 de large, et au-dessous, entre les pieds, 2 planches de 10 pieds au moins de long, pour déposer les papiers des écoliers ; il y a 3 bancs de 12 pieds environ de long aux côtés de la table, et des sièges de bois tout autour de la salle avec des planches au-dessus contre les murs, également pour déposer les livres des écoliers, une armoire de bois de chêne, fermant à clef et serrure, attachée contre le mur, et une chaise à bras, ou fauteuil enfoncé de paille, pour l’usage du maître d’école ; au dehors de ladite salle, 2 pieds de largeur de terrain sur l’étendue de la salle, servant de passage avec le voisin, la cour, la salle et étable avec grenier se tenant ensemble, dont le maître d’école ne pourra rien affermer, la moitié du jardin potager sis derrière la maison de l’école et du voisin, 2 sillons de terre avec pommiers à Villiers-le-Sec, delle des Crottes-Hamelin, contenant environ 5 vergées, avec les héritages de 2 vergées ½ en 2 sillons paroisse du Manoir, 80 livres de rente foncière, assise à Vaussieux, 10 livres de rente foncière, assise à Villiers-le-Sec, 23 livres de rente foncière, assise audit Villiers-le-Sec. Si les paroissiens refusent de faire les grosses réparations, le maître d’école leur signifiera qu’il les fera à ses frais et dépens , parce que pour s'en faire récompenser il fera payer par les parents des écoliers 6 sols par mois pour les lecteurs et 8 pour les écrivains, jusqu’à remboursement; il cessera d’instruire ceux qui ne voudront payer ledit écolage. En cas d’élection d’un maître d'école choisi autrement qu’en les formes susdites, sans le consentement du seigneur, substitution au bénéfice des pauvres malades de l’Hôpital de Bayeux, pour fondation d’un lit auquel le seigneur nommera.